Au-delà de l’intérêt patrimonial ou historique, éditer les penseurs anarchistes et faire circuler les théories et expériences libertaires, c’est continuer d’interroger le rapport de nos sociétés au pouvoir, aux dominations et à l’autorité.
Théo Roumier
15 juin 2025
« Ainsi« Ainsi l’idée libertaire est, depuis peu, ressortie du cône d’ombre où ses détracteurs la reléguaient. » L’affirmation pourrait paraître récente. Elle conclut pourtant un petit ouvrage publié il y a pile soixante ans. L’Anarchisme. De la doctrine à l’action, écrit par l’historien et militant Daniel Guérin, paraît dans la collection de poche « Idées » chez Gallimard en 1965. Véritable best-seller dans la foulée des mois de mai et juin 1968, son tirage dépassera les 100 000 exemplaires – le livre, désormais disponible en Folio, est toujours réimprimé.
Son succès doit alors beaucoup à ce qu’une bonne partie des « idées-forces » de l’anarchisme se conjuguent au mouvement de mai : contestation du pouvoir, de l’État comme du Capital ; rejet viscéral des hiérarchies instituées, de l’école à l’usine, et attachement farouche à l’émancipation, collective et individuelle ; mépris de la légalité des puissants ; dénonciation de l’électoralisme, exaltation de la base et promotion de l’action et de la démocratie directe.
Guérin voit aussi dans la fortune du thème de l’autogestion l’une de ces métamorphoses. Malgré cela, dans ce qu’il est coutume d’appeler désormais les « années 68 », les pensées marxistes – « autoritaires » d’un point de vue libertaire – dominent.

Un symbole anarchiste le 02 juin 2023 sur un mur à Berlin. © Photo Wolfram Steinberg / DPA via AFP
Aujourd’hui cette époque est derrière nous, mais l’on trouvera pourtant plus facilement Emma Goldman ou Kropotkine en librairie que Lénine ou Trotski. Dans un monde frappé par l’urgence, voilà qui peut sembler paradoxal quand, à gauche, l’imaginaire de l’efficacité l’emporte trop souvent sur l’exigence de démocratie, et l’autorité verticale sur l’horizontalité des mouvements sociaux.
Éclipse et renouveau
Ayant survécu à l’éclipse des années 1980, l’option libertaire retrouve des couleurs au mitan des années 1990. Outre-Atlantique, la rébellion zapatiste de 1994 et l’ouverture du cycle altermondialiste avec la bataille de Seattle en 1999 en sont les premiers jalons. Le Mexique insurgé nourrit les thèses du politologue John Holloway, dont le livre Changer le monde sans prendre le pouvoir (Pluto Press, 2002, coédition en français Lux-Syllepse, 2008) sonne comme un manifeste. Quant à l’anthropologue et anarchiste David Graeber, disparu prématurément en 2020, crédité de l’invention du slogan « Nous sommes les 99 % », il s’impliquera activement dans le mouvement Occupy Wall Street.
En France, ce sont les grandes grèves de novembre-décembre 1995 et leur « brise libertaire » qui font office de déclencheur. La montée de l’extrême droite réactive par ailleurs la mémoire de l’Espagne antifasciste, teintée de rouge et noir. L’écrivain de polar Jean-Bernard Pouy lance les aventures du Poulpe, « enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude ».
Quand on lit Pouget, on n’a plus envie d’aller “dialoguer” en CSE !
Guillaume Goutte, militant CGT
Une collection de livres de poche bon marché comme Mille et une nuits republie Bakounine. Symptomatique de ce regain d’intérêt, en 2001, le « Que sais-je ? » sur l’anarchisme aux Presses universitaires de France – qui était celui d’Henri Arvon… depuis 1951 – est confié à l’historien libertaire Gaetano Manfredonia, avant de l’être au Québécois Normand Baillargeon en 2024.
En quelques années, tout un écosystème va se mettre en place, combinant éditions, revues, librairies. Bien sûr, parce qu’il s’agit d’une tâche de propagande traditionnelle, les organisations constituées du mouvement libertaire y contribuent. Mais, même s’il y a des précurseurs, tels Acratie, l’Atelier de création libertaire, La Digitale ou L’insomniaque, ce sont de jeunes maisons indépendantes – L’Échappée, Nada, Libertalia (pour ne citer que les plus en vue) – qui vont porter ce renouveau, non sans résonance avec l’actualité.
La CGT et Emma Goldman
Prenons la question syndicale. La CGT en France, dont on fête les 130 ans, fut à l’origine animée pour partie par des anarchistes : l’occasion de relire une de ses meilleures plumes, Émile Pouget, ou encore le théoricien des bourses du travail à leur naissance, Fernand Pelloutier.
Leurs republications récentes chez Nada — Le Sabotage du premier en 2021 et Aux anarchistes du second en 2023 – sont accompagnées de préfaces de Guillaume Goutte. Militant CGT d’aujourd’hui, il appelle à en assumer l’héritage pour « sortir le syndicalisme du cadre institutionnel dans lequel il s’est englué ».
Renouer avec l’action directe, voilà l’enjeu : « Quand on lit Pouget, on n’a plus envie d’aller “dialoguer” en CSE ! » Autre perspective, la réunification du syndicalisme pour qu’émerge un « Parti du travail » (pour reprendre la formule de Pouget) digne de ce nom, à même de « rééquilibrer » une gauche qui a peut-être trop le nez dans le guidon des échéances électorales.
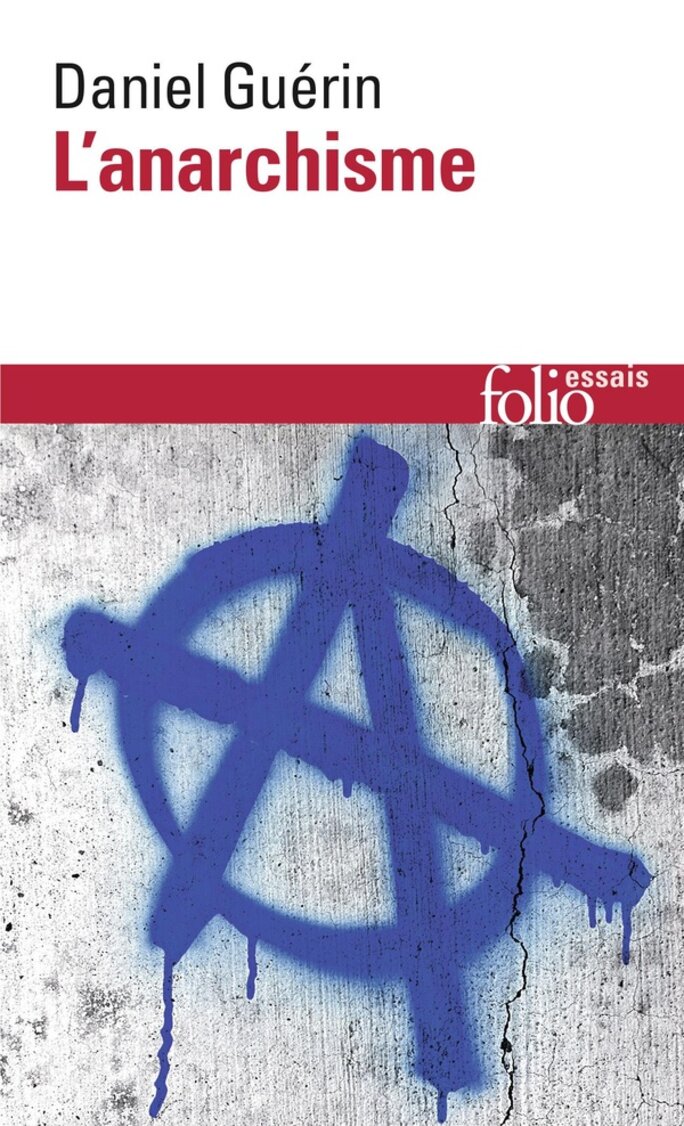
Du courant anarchiste ont aussi émergé des figures de l’émancipation des femmes. Emma Goldman en est sans doute une des plus représentatives. Ses mémoires intitulés Vivre ma vie (L’Échappée, 2018) témoignent d’une existence de révolte et d’audace, prônant l’amour libre, dénonçant « l’âge d’or » du capitalisme états-unien, traversant les révolutions russe et espagnole.
Pour Léa Gauthier, sa préfacière et traductrice chez Payot (qui prépare, avec Hélène Aldeguer au dessin, un roman graphique sur sa vie à paraître chez Futuropolis), Emma Goldman « est la première à penser la libération des corps d’une manière aussi radicale ». Attaché à l’émancipation plus qu’à la violence et à la destruction, son anarchisme est « une pensée déstabilisante [de l’ordre établi] qui mérite pour cela d’être revisitée ».
Un titre comme Ni dieu ni patron ni mari (Nada, 2023) fait également traverser le temps à l’expérience de La Voz de la Mujer, publication argentine qui connut neuf numéros de 1896 à 1897. Le journal « communiste-anarchiste », porté par des femmes de la classe ouvrière « déterminées et sur la brèche », dénonce l’exploitation tant à l’atelier qu’au foyer. Tout cela participe d’une réparation salutaire et de l’affirmation d’une culture féministe.
Autre réparation, la mise en avant de militant·es racisé·es méconnu·es, comme Mohamed Saïl (1894-1953) et ses « écrits d’un anarchiste kabyle » (L’Étrange Étranger, Lux, 2020) ou Lucy Parsons (1851-1942), syndicaliste et anarchiste aux États-Unis (Travailler dans ces conditions ? Jamais !, Payot, 2024 ; Je m’appelle révolution, Lux, 2024).
Mais l’anarchisme n’a-t-il finalement de valeur que patrimoniale ? N’est-il cantonné qu’à quelques salles flamboyantes au musée du Mouvement ouvrier ?
Dans son livre de référence, Daniel Guérin l’exprimait sans détour : « La défaite de la Révolution espagnole [en 1936-1939 – ndlr] a privé l’anarchisme de son seul et unique bastion dans le monde. » Il n’en concluait pas pour autant à sa disparition, pariant sur sa capacité de réinvention.
L’envie d’accéder au pouvoir est un vertige politique dont la gauche s’est rendue largement malade.
Olivier Besancenot
Après le Chiapas zapatiste où l’on « commande en obéissant », certains voient désormais dans le confédéralisme démocratique du Rojava une autre de ses métamorphoses, prenant le relais des collectivisations de la révolution espagnole. D’autant que les révolutionnaires kurdes s’inspirent des théories du communaliste libertaire Murray Bookchin.
Plus près de nous, ce communalisme a été présent dans une frange du mouvement des « gilets jaunes », notamment impulsé par l’Assemblée citoyenne de Commercy. Des « zones autonomes temporaires » théorisées par Hakim Bey (TAZ, Éditions de l’éclat, 1997) aux ZAD contemporaines, on retrouve cette idée de « libérer » des espaces de l’autorité de l’État. Est-ce que cela suffit à dessiner une alternative autre que locale ? C’est toute la question du pouvoir qui est posée si l’on veut aller au-delà.
Sur le sujet, une dose de sérum libertaire pourrait bénéficier à d’autres traditions politiques, si ce n’est à toute la gauche. Pour Olivier Besancenot, qui vient de publier un libelle dynamitant le présidentialisme et dont le livre coécrit avec Michael Löwy sur les « affinités révolutionnaires » entre marxistes et libertaires reparaît, « Louise Michel avait raison, le pouvoir est vraiment maudit. L’envie d’y accéder est un vertige politique dont la gauche s’est rendue largement malade ». Plutôt que de chercher à « prendre » le pouvoir, en inventer un autre exercice et d’autres formes nécessite, selon lui, d’intégrer « la critique libertaire dans notre ADN ».
Véhiculer l’idée libertaire
En 2017, les deux premiers épisodes de la série documentaire Ni Dieu ni maître,une histoire de l’anarchisme de Tancrède Ramonet rassemblent plus de 400 000 téléspectateurs et téléspectatrices sur la chaîne Arte, un très bel écho.
Et une répercussion certaine dans l’édition. Si l’on n’atteint pas le succès du Résister de Salomé Saqué (plus de 150 000 exemplaires vendus), il se passe quand même quelque chose. Pour Rachel Viné-Krupa, de Nada, le livre reste « un excellent véhicule pour les idées anars », à condition de réussir à toucher un public autre que militant.
C’est l’ambition de la Petite bibliothèque anarchiste chez le même éditeur ou de la collection « Instincts de liberté » chez Lux. Avec une certaine réussite. Tiré à 8 000 exemplaires, le petit recueil Ni dieu ni patron ni mari s’est déjà écoulé à 6 000. Ces textes « circulent sans doute plus aujourd’hui qu’à l’époque », note David Doillon, binôme de Rachel Viné-Krupa.
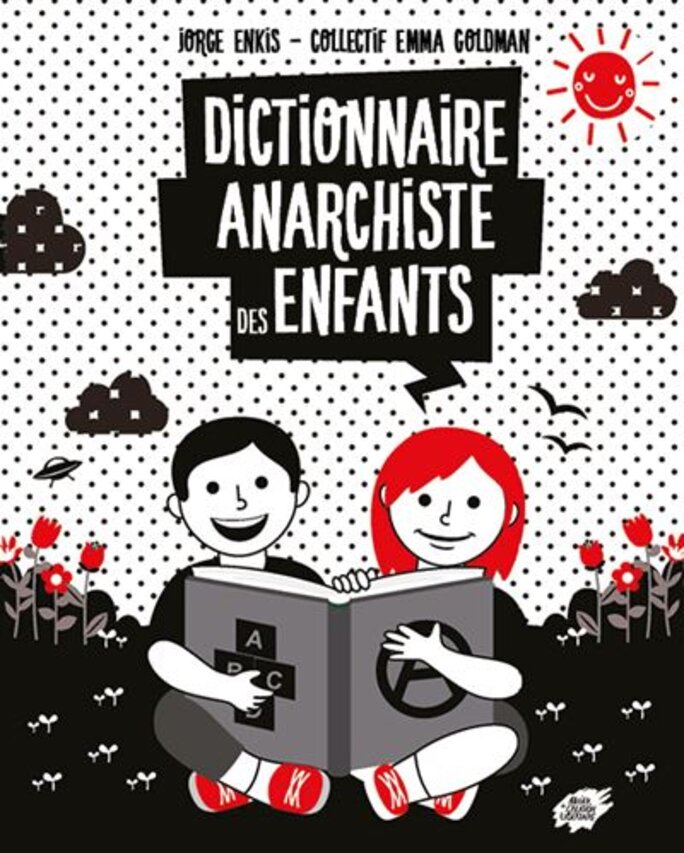
Dans un registre similaire, le Dix questions sur l’anarchisme signé de Guillaume Davranche – une des chevilles ouvrières du Maitron des anarchistes et membre de l’Union communiste libertaire – a franchi la barre des 10 000 exemplaires vendus depuis sa parution en 2020 chez Libertalia. Le Dictionnaire anarchiste des enfants paru en 2022 à l’Atelier de création libertaire, les 12 000.
Des maisons plus généralistes s’y risquent. C’est le cas de Payot, qui publie depuis peu des petits volumes reconnaissables à leur couverture frappée d’un A cerclé rouge et de portraits réalisés par le dessinateur Fred Sochard.
Les ventes de livres dépassent quoi qu’il en soit largement les effectifs des organisations anarchistes existantes. Voyons-y une bonne nouvelle. Dans une période où les gauches sociales et politiques cherchent les moyens de s’opposer à un cours du monde toujours plus réactionnaire, continuer d’interroger le rapport de nos sociétés au pouvoir et aux dominations, comme proposer d’autres voix de l’émancipation, est sans doute loin d’être superflu. Une très bonne raison, finalement, de continuer à éditer l’anarchisme.
Théo Roumier